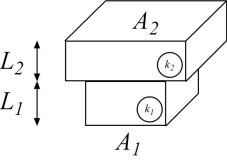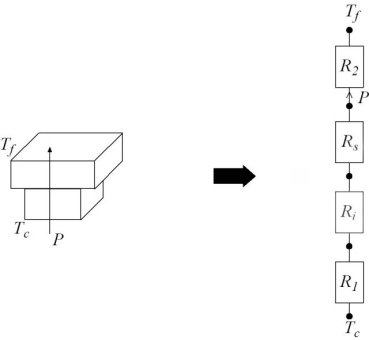www.leguman.ht.st
| pertes de charges |
pompes |
CONDUCTION |
| Ce qu'il faut retenir |
©
2001 - 2002.
|
| prédédent | ||
|
Résistance de surface Compliquons un peu plus et on en vient maintenant au cas où les surfaces des deux plaques en contact n'ont pas la même aire et regardons l'impact sur la deuxième plaque.
C'est utile dans la mesure où, comme on l'a vu au début
de cet article, augmenter l'aire de la surface diminue la résistance
thermique. Mais là intervient un autre facteur qui traduit
une des faiblesse de la loi de Fourier version light : la chaleur
ne se repartit pas "uniformément" sur toute la
seconde surface supérieure A2,
ainsi, bien que cette dernière soit plus grande, les échanges
thermiques seront plus importants au centre, comme si on n'utilisait
seulement qu'une partie de la seconde surface ; ce qui réduit
l’intérêt d'augmenter la surface ! Pourquoi l'épaisseur ? parce qu'il faut "laisser la
place" à la chaleur pour qu'elle puisse mieux se répartir
sur toute la surface supérieure de la seconde plaque, plus
l'épaisseur est grande, plus Rs
est petite.
Ceux qui ont tout suivi jusqu'ici se diront : euh, il a dit avant
que la résistance thermique augmente avec l'épaisseur
mais ici elle diminue ?! En effet, le choix de l'épaisseur
de la seconde plaque n'est pas évident car si elle est plus
grande, Rs
diminue, mais par contre R2
augmente. |
||
| prédédent |